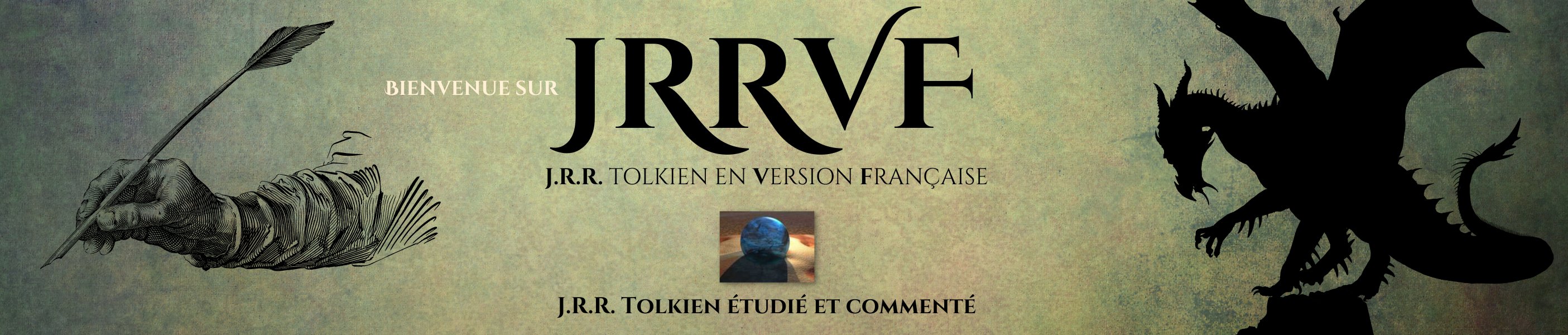Table des matières
Peut-on apprendre les langues inventées par Tolkien ?
Pas vraiment, du moins pas de la même façon que l’on peut apprendre une langue vivante. Il est plus approprié de parler d’étude. L’intérêt de Tolkien n’était manifestement pas de faire de ses langues des instruments de communication ; il s’attachait avant tout à leur construction, leur esthétique, et se délectait à envisager leur évolution dans le cadre historique fictif de sa mythologie.
En découlent plusieurs conséquences.
Premièrement, aucune d’elle n’est ” complète ” : même pour les mieux documentées que sont le quenya et le sindarin, des pans importants de la grammaire sont obscurs.
Deuxièmement, tout au long de sa vie Tolkien n’a cessé de le retoucher, les modifier, les remanier de telle sorte qu’un point de grammaire bien établi à une période donnée peut très bien ne plus être valable pour une autre. On voit certaines conceptions apparaître, disparaître… et parfois reparaître des années plus tard ! Un exemple frappant est celui du mot quenya lá qui a longtemps signifié ” non “, puis est devenu ” oui ” dans les années 1960 avant de redevenir ” non ” vers 1970 !
Troisièmement, nous ne disposons pas d’exposé complet de ses langues par leur auteur, mais de quelques fragments de grammaires inachevées et de monceaux de données éparpillées dans ses écrits, le tout réparti sur une soixantaine d’années, avec les innombrables changements de conception que cela suppose. Notre connaissance de ces langues résulte essentiellement du classement et de l’interprétation de ces témoignages (pour une part encore inédits) ; travail long, délicat et que l’on peut toujours renouveler. C’est d’ailleurs un intérêt majeur de cette étude.
Quatrièmement, si nous avons un certain nombre d’informations dispersées sur la grammaire et le vocabulaire, il y a très peu de véritables textes qui permettent de voir la langue réellement fonctionner. Imaginez que quelqu’un apprenne le français à partir d’un dictionnaire et d’un tableau de conjugaison, le résultat aurait peu de chances d’être même simplement intelligible.
Il ressort de cela que plus qu’à apprendre, ces langues sont à étudier dans leurs mécanismes et leur évolution tant de manière interne qu’externe. L’approche interne consiste raisonner selon la logique du récit : Tolkien n’a pas inventé ses langues dans le vide, à chaque époque de sa vie il est censé exister un cadre linguistique cohérent qui les intègre au sein de sa mythologie, avec leur histoire, leurs parentés, leurs évolutions parallèles à celles des peuples. En termes tolkieniens cela revient à se placer dans le monde secondaire, terme qui désigne sa création (ou, comme il l’appelle, sub-création), par opposition au monde primaire qui est notre ” monde réel “. L’approche externe considère ces langues dans le monde primaire : leur développement tout au long de la vie de leur auteur, les influences qu’elles ont subi de la part de langues naturelles, leurs transformations en lien avec celles des récits, etc.
Peut-on s’y exprimer ?
Le second vient du problème que pose la définition d’une norme. S’exprimer et se comprendre dans quelque langue que ce soit nécessite l’existence de règles, qui sont une convention entre les usagers de la langue et en forment le système. Ce sont elles qui nous permettent de sentir qu’une phrase comme ” Je du pain mange ” n’est pas du français correct (même s’il reste compréhensible ici) : nul de langue maternelle française ne produirait spontanément une telle phrase.
Dans une langue vivante, du moins dans l’usage spontané, la convention est implicite et les locuteurs n’ont pas besoin d’en être conscients pour s’exprimer de manière satisfaisante. L’étude des énoncés qu’ils produisent permet alors de mettre au jour la convention employée : cette approche est dite descriptive. L’autre approche est prescriptive : elle pose a priori la norme que doit suivre l’usage défini comme correct, comme en français le ” bon usage “.
Pour une langue construite comme celles qu’inventa Tolkien, il n’existe précisément pas d’usagers spontanés : l’approche prescriptive est donc la seule possible si l’on souhaite s’y exprimer, sans quoi il serait impossible de se comprendre. Or la norme y est très difficile à définir. Tolkien n’ayant jamais cessé de remanier ses langues (cf. question n° 1), bien des règles ne sont valables qu’à une période donnée de sa vie, et il est souvent délicat de savoir si elles sont contemporaines entre elles, car les informations linguistiques sont très dispersées dans ses écrits. De toute façon, il est nécessaire de faire un choix : il est conventionnel et comporte donc nécessairement une part d’arbitraire, source infinie de contestations. Le plus souvent, c’est le quenya ou le sindarin tel qu’illustré dans Le Seigneur des Anneaux qui est visé : mais comme les ressources en sont largement trop maigres pour qu’on puisse en tirer moyen de s’y exprimer, il faut recourir à d’autres documents ; immédiatement se pose alors le problème de leur compatibilité.
Pour compliquer les choses, il existe de plus des variations de norme à l’intérieur d’une même langue. Une langue n’est pas un système entièrement homogène, mais un ensemble organisé de sous-systèmes cohérents (cf. E. Kloczko, Dictionnaire des langues elfiques vol. 1) . Des variétés plus ou moins divergentes peuvent se parler dans des régions distinctes, constituant des dialectes. Il existe des différences selon la situation de communication, qui constituent les registres : comparer en français ” Chais pas “, ” Je ne sais pas “, ” Je ne sais ” Certains usages sont propres à des groupes sociaux particuliers : cela concerne notamment de nombreux termes techniques. Ces questions ne sont pas absentes des langues de Tolkien.
Combien de langues Tolkien créa-t-il ?
Le second vient du problème que pose la définition d’une norme. S’exprimer et se comprendre dans quelque langue que ce soit nécessite l’existence de règles, qui sont une convention entre les usagers de la langue et en forment le système. Ce sont elles qui nous permettent de sentir qu’une phrase comme ” Je du pain mange ” n’est pas du français correct (même s’il reste compréhensible ici) : nul de langue maternelle française ne produirait spontanément une telle phrase.
Dans une langue vivante, du moins dans l’usage spontané, la convention est implicite et les locuteurs n’ont pas besoin d’en être conscients pour s’exprimer de manière satisfaisante. L’étude des énoncés qu’ils produisent permet alors de mettre au jour la convention employée : cette approche est dite descriptive. L’autre approche est prescriptive : elle pose a priori la norme que doit suivre l’usage défini comme correct, comme en français le ” bon usage “.
Pour une langue construite comme celles qu’inventa Tolkien, il n’existe précisément pas d’usagers spontanés : l’approche prescriptive est donc la seule possible si l’on souhaite s’y exprimer, sans quoi il serait impossible de se comprendre. Or la norme y est très difficile à définir. Tolkien n’ayant jamais cessé de remanier ses langues (cf. question n° 1), bien des règles ne sont valables qu’à une période donnée de sa vie, et il est souvent délicat de savoir si elles sont contemporaines entre elles, car les informations linguistiques sont très dispersées dans ses écrits. De toute façon, il est nécessaire de faire un choix : il est conventionnel et comporte donc nécessairement une part d’arbitraire, source infinie de contestations. Le plus souvent, c’est le quenya ou le sindarin tel qu’illustré dans Le Seigneur des Anneaux qui est visé : mais comme les ressources en sont largement trop maigres pour qu’on puisse en tirer moyen de s’y exprimer, il faut recourir à d’autres documents ; immédiatement se pose alors le problème de leur compatibilité.
Pour compliquer les choses, il existe de plus des variations de norme à l’intérieur d’une même langue. Une langue n’est pas un système entièrement homogène, mais un ensemble organisé de sous-systèmes cohérents (cf. E. Kloczko, Dictionnaire des langues elfiques vol. 1) . Des variétés plus ou moins divergentes peuvent se parler dans des régions distinctes, constituant des dialectes. Il existe des différences selon la situation de communication, qui constituent les registres : comparer en français ” Chais pas “, ” Je ne sais pas “, ” Je ne sais ” Certains usages sont propres à des groupes sociaux particuliers : cela concerne notamment de nombreux termes techniques. Ces questions ne sont pas absentes des langues de Tolkien.
Peut-on s’y exprimer ?
En résumé : si nous considérons les versions ” historiques ” des langues qui se rapportent à la forme classique de la mythologie d’Arda, Tolkien développa 2 langues qui sont vaguement ” utilisables ” (…) nomma approximativement 8-10 autres langues qui possèdent un minimum de substance véritable mais qui ne sont en aucun cas utilisables, fournit de simples fragments d’au moins 4 autres langues, et fit allusion à de nombreuses autres langues qui sont soit entièrement fictives ou possèdent un vocabulaire connu d’un seul ou de très peu de véritables mots.
La réponse courte à la question ” combien de langues ? ” donne ceci : ” En dehors des langues extrêmement fragmentaires ou entièrement fictives, il fournit une quantité d’informations variable sur dix ou douze autres langues, mais seulement deux d’entre elles sont hautement développées avec des vocabulaires substantiels. “
Peut-on s’y exprimer ?
Le second vient du problème que pose la définition d’une norme. S’exprimer et se comprendre dans quelque langue que ce soit nécessite l’existence de règles, qui sont une convention entre les usagers de la langue et en forment le système. Ce sont elles qui nous permettent de sentir qu’une phrase comme ” Je du pain mange ” n’est pas du français correct (même s’il reste compréhensible ici) : nul de langue maternelle française ne produirait spontanément une telle phrase.
Dans une langue vivante, du moins dans l’usage spontané, la convention est implicite et les locuteurs n’ont pas besoin d’en être conscients pour s’exprimer de manière satisfaisante. L’étude des énoncés qu’ils produisent permet alors de mettre au jour la convention employée : cette approche est dite descriptive. L’autre approche est prescriptive : elle pose a priori la norme que doit suivre l’usage défini comme correct, comme en français le ” bon usage “.
Pour une langue construite comme celles qu’inventa Tolkien, il n’existe précisément pas d’usagers spontanés : l’approche prescriptive est donc la seule possible si l’on souhaite s’y exprimer, sans quoi il serait impossible de se comprendre. Or la norme y est très difficile à définir. Tolkien n’ayant jamais cessé de remanier ses langues (cf. question n° 1), bien des règles ne sont valables qu’à une période donnée de sa vie, et il est souvent délicat de savoir si elles sont contemporaines entre elles, car les informations linguistiques sont très dispersées dans ses écrits. De toute façon, il est nécessaire de faire un choix : il est conventionnel et comporte donc nécessairement une part d’arbitraire, source infinie de contestations. Le plus souvent, c’est le quenya ou le sindarin tel qu’illustré dans Le Seigneur des Anneaux qui est visé : mais comme les ressources en sont largement trop maigres pour qu’on puisse en tirer moyen de s’y exprimer, il faut recourir à d’autres documents ; immédiatement se pose alors le problème de leur compatibilité.
Pour compliquer les choses, il existe de plus des variations de norme à l’intérieur d’une même langue. Une langue n’est pas un système entièrement homogène, mais un ensemble organisé de sous-systèmes cohérents (cf. E. Kloczko, Dictionnaire des langues elfiques vol. 1) . Des variétés plus ou moins divergentes peuvent se parler dans des régions distinctes, constituant des dialectes. Il existe des différences selon la situation de communication, qui constituent les registres : comparer en français ” Chais pas “, ” Je ne sais pas “, ” Je ne sais ” Certains usages sont propres à des groupes sociaux particuliers : cela concerne notamment de nombreux termes techniques. Ces questions ne sont pas absentes des langues de Tolkien.