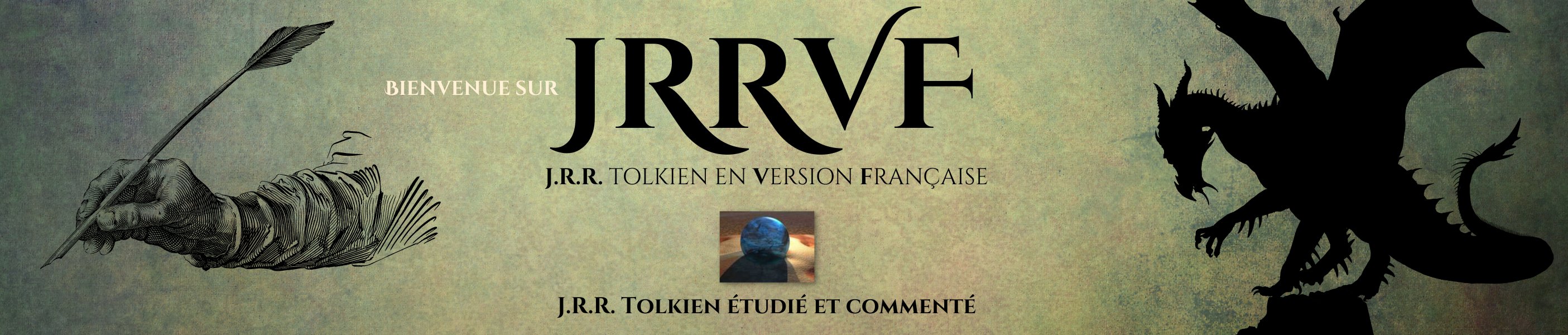[5]
[10]
Once upon a day on the fields of May
there was snow in the summer where the blossom lay;
the buttercups tall sent up their light
in a stream of gold, and wide and white
there opened in the green grass-skies
the earth-stars with their steady eyes
watching the Sun climb up and down.
Goldberry was there with a wild-rose crown,
Goldberry was there in a lady-smock ,
blowing away a dandelion clock,
stooping over a lily-pool
and twiddling the water green and cool
to see it sparkle round her hand:
once upon a time in elvish land.
Il était un jour sur les champs et prés de Mai,
de la neige en belle saison qui fleurissait ;
les hauts boutons d’or éparpillaient leur lumière
en un ru doré, et dans les cieux d’herbe verts
s’épanouissaient, larges et toutes en blanc,
les étoiles-de-terre dont les regards francs
observaient le Soleil descendre et remonter.
Baie d’Or était là, encouronnée d’églantier,
Baie d’Or était là, vêtue d’une chemisette,
dents-de-lion à la main, elle en soufflait l’aigrette,
se penchait au-dessus d’un bassin vert et frais
plein de lis d’eau, jouait de l’onde, la remuait
pour qu’elle s’éclabousse autour de sa main : plic !
il était une fois dans les contrées elfiques.
Il était un jour sur les champs et prés de Mai,
de la neige en belle saison qui fleurissait ;
les hauts boutons d’or éparpillaient leur lumière
en un ru doré, et dans les cieux d’herbe verts
s’épanouissaient, larges et toutes en blanc,
les étoiles-de-terre dont les regards francs
observaient la Soleil descendre et remonter.
Baie d’Or était là, encouronnée d’églantier,
Baie d’Or était là, vêtue d’une chemisette,
dents-de-lion à la main, elle en soufflait l’aigrette,
se penchait au-dessus d’un bassin vert et frais
plein de lis d’eau, jouait de l’onde, la remuait
pour qu’elle s’éclabousse autour de sa main : plic !
il était une fois dans les contrées elfiques.
[15]
[20]
[25]
Once upon a night in the cockshut light
the grass was grey but the dew was white;
shadows were dark, and the Sun was gone,
the earth-stars shut, but the high stars shone,
one to another winking their eyes
as they waited for the Moon to rise.
Up he came, and on leaf and grass
his white beams turned to twinkling glass,
and silver dripped from stem and stalk
down to where the lintips walk
through the grass-forests gathering dew.
Tom was there without boot or shoe,
with moonshine wetting his big, brown toes:
once upon a time, the story goes.
Il était une nuit, lueur de brune bise,
de la rosée blanche qui mouillait l’herbe grise ;
les ombres étaient noires, le Soleil était couché,
et les étoiles-de-terre s’étaient fermées ;
mais les étoiles hautes brillaient dans les cieux,
et attendaient la Lune en se clignant des yeux.
Elle se leva, vit changer ses rayons blancs
sur les feuilles et l’herbe en verre étincelant,
des tiges et des chaumes l’argent ruisselait,
jusqu’en bas, là où se promenaient les linets
par les forêts d’herbe, en ramassant la rosée.
Tom était là, le pied sans botte ni soulier,
la Lune mouillant ses grands orteils bruns et nus :
il était une fois, l’histoire continue.
Il était une nuit, lueur de brune bise,
de la rosée blanche qui mouillait l’herbe grise ;
les ombres étaient noires, la Soleil était couchée,
et les étoiles-de-terre s’étaient fermées ;
mais les étoiles hautes brillaient dans les cieux,
et attendaient le Lune en se clignant des yeux.
Lui se leva, et vit changer ses rayons blancs
sur les feuilles et l’herbe en verre étincelant,
des tiges et des chaumes l’argent ruisselait,
jusqu’en bas, là où se promenaient les linets
par les forêts d’herbe, en ramassant la rosée.
Tom était là, le pied sans botte ni soulier,
le Lune mouillant ses grands orteils bruns et nus :
il était une fois, l’histoire continue.
[30]
[35]
[40]
Once upon a moon on the brink of June
a-dewing the lintips went too soon.
Tom stopped and listened, and down he knelt:
“Ha! Little lads! So it was you I smelt?
What a mousy smell! Well, the dew is sweet,
so drink it up, but mind my feet!”
The lintips laughed and stole away,
but old Tom said: “I wish they’d stay!
The only things that won’t talk to me,
say what they do or what they be.
I wonder what they have got to hide?
Down from the Moon maybe they slide,
or come in star-winks, I don’t know”:
once upon a time and long ago.
Il était une lune au tout début de Juin
des linets qui cherchèrent rosée trop matin.
Tom s’arrêta, écouta et s’agenouilla :
« Eh ! Petits gars ! C’était vous que je sentais là ?
Quelle odeur discrète ! Bien, la rosée est miellée,
Buvez-la donc, mais prenez bien garde à mes pieds ! »
Les linets s’esclaffèrent et s’esquivèrent, lestes,
mais le vieux Tom dit : « J’aurais tant aimé qu’ils restent !
Ce sont les seuls êtres qui ne me parlent pas,
ce qu’ils font, ce qu’ils sont, ils ne le disent pas.
Pourquoi ont-ils dû se cacher ? Ils ont glissé
depuis la Lune peut-être, ou sont arrivés,
je ne sais, par les étoiles, dans leurs clignements. » :
il était une fois, il y a bien longtemps.
Il était un lune au commencement de Juin
des linets qui cherchèrent rosée trop matin.
Tom s’arrêta, écouta et s’agenouilla :
« Eh ! Petits gars ! C’était vous que je sentais là ?
Quelle odeur discrète ! Bien, la rosée est miellée,
Buvez-la donc, mais prenez bien garde à mes pieds ! »
Les linets s’esclaffèrent et s’esquivèrent, lestes,
mais le vieux Tom dit : « J’aurais tant aimé qu’ils restent !
Ce sont les seuls êtres qui ne me parlent pas,
ce qu’ils font, ce qu’ils sont, ils ne le disent pas.
Pourquoi ont-ils dû se cacher ? Ils ont glissé
depuis le Lune peut-être, ou sont arrivés,
je ne sais, par les étoiles, dans leurs clignements. » :
il était une fois, il y a bien longtemps.
Énigmes et linets
Ce très beau poème est fort peu connu dans la tradition, mais il appartient visiblement à la même branche : le sujet traité est évidemment bombadilien, et la structure des vers est identique, ce qui nous mène à penser qu’ils sont bien liés. Peut-être est-ce encore une composition du Pays de Bouc, comme les deux précédentes.
Bien qu’il soit plus court, sa traduction ne fut pas plus évidente, l’auteur nous gratifiant même d’une énigme assez ardue : que sont les lintips ? De toute évidence, et du strict point de vue de la construction du nom, un composé de lin et tip ; si la deuxième partie ne pose pas de problème à traduire — extrémité, pointe, bout — la première est plus ardue. Elle n’a pas de sens en anglais moderne, et il faut remonter loin dans l’histoire de la langue pour trouver lin (aussi orthographié linn et lyn). Il viendrait de l’irlandais linn ou du gaélique linne, voisin du gallois llyn, “bassin, étang, lac”, et désignait un bassin — et plus précisément un bassin au dessus ou au dessous d’une chute d’eau[1]. Cette piste est confirmée par la ressemblance avec le lîn sindarin, qui signifie “étang”. Il fallait donc, pour franciser le terme, privilégier cette racine, même s’il semblait peu probable qu’elle fut utilisée dans notre langue… Et pourtant, si : l’actuel lenn breton, qui signifie “marais”, dérive d’un vieux breton lin. Une racine semblable pour un nom aquatique ne pouvait mieux tomber ! Mais il ne fallait pas pousser le vice jusqu’à traduire littéralement par linbout : la sonance n’était pas du tout la même, et il me paraissait tout aussi important de traduire le sens que le symbolisme sonore, cristallin et léger. Le diminutif –et était donc tout indiqué, et linet garde à la fois le double sens et l’évocation sonore. Il ne renseigne pourtant pas sur ce que sont les linets, et nous voilà, tout autant que Tom, réduits aux hypothèses ; car si lui, l’Ancien, l’ignore, lui qui sait tous les noms et tous les chants, lui qui est le Maître, comment pourrions-nous dès lors émettre un jugement péremptoire à leur sujet ? Appartenaient-ils encore au bestiaire des Hobbits au moment où le poème fut composé — sachant que ce moment peut-être très éloigné de celui où il fut retranscrit —, où étaient-ils déjà un simple nom étrange illustrant une légende ? Rien ne nous l’indique, et c’est cette énigme qui ajoute au charme du poème.
Une autre difficulté, à vrai dire, plus une question métaphysique, fut de choisir entre traduire le Soleil et la Lune, ou la Soleil et le Lune. Les genres sont inversés, par rapport au français, dans l’original (sauf au vers 29, ou « moon » perd sa majuscule, et me semble revenir au neutre). Fallait-il, au nom de la lisibilité externe, garder nos genres (Soleil masculin et Lune féminin), ou sacrifier à la tradition (et à la symbolique qu’elle sous-tend) présente dans le poème ? Je n’ai pas encore tranché, les deux aspects présentant autant d’arguments en leur faveur… Les genres du soleil et de la lune sont inscrits dans le nom même en français, par leur terminaison : -eil est masculin (le féminin étant –eille, comme dans corneille), -une féminin (masculin -un, comme dans tribun). De plus, leur genre est culturellement enraciné dans les esprits. D’autre part, la tradition elfique est claire en inversant les genres par rapport à nous, et de toute évidence, c’est cette tradition qui ressort dans l’original, et pas simplement le fait que les Hobbits masculinisent la lune et féminisent le soleil — tout comme les Saxons chez nous : voir l’allemand Der Mond (cf. l’anglais Monday), masculin, et Die Sonne, féminin. Ne pouvant trancher, j’ai laissé les deux versions : au lecteur de choisir celle qu’il préfère.
Quant à la structure même du poème, elle m’a aussi donné du fil à retordre. Chaque strophe commence et finit de la même manière : Once upon a day/night/moon, // Once upon a time. Il était alors obligatoire de conserver ce parallélisme dans la traduction, mais il m’a été impossible de conserver la rime interne des premiers vers de chaque strophe (day/May pour la première, night/light pour la seconde, et moon/June pour la dernière).
Notes
- [1] Webster’s 1913 Dictionary :
- 1. \Lin\ (l[i^]n), v. i. [AS. linnan. See {Lithe}.] : To yield; to stop; to cease. [Obs. or Scot.] –Marston.
- 2. \Lin\, v. t.: To cease from. [Obs. or Scot.]
- 3. \Lin\, n. [Ir. linn, or Gael. linne; akin to W. llyn a pool, pond, lake, but in senses 2 and 3 prob. from AS. hlynn
- torrent. Cf. {Dunlin}.]
- 1. A pool or collection of water, particularly one above or below a fall of water.
- 2. A waterfall, or cataract; as, a roaring lin.
- 3. A steep ravine.
Note: Written also linn and lyn.
(SOURCE : http://www.hyperdictionary.com)

| [5]
[10] |
Once upon a day on the fields of May there was snow in the summer where the blossom lay; the buttercups tall sent up their light in a stream of gold, and wide and white there opened in the green grass-skies the earth-stars with their steady eyes watching the Sun climb up and down. Goldberry was there with a wild-rose crown, Goldberry was there in a lady-smock , blowing away a dandelion clock, stooping over a lily-pool and twiddling the water green and cool to see it sparkle round her hand: once upon a time in elvish land. |
Il était un jour sur les champs et prés de Mai, |
Il était un jour sur les champs et prés de Mai, |
|
[15] [20] [25] |
Once upon a night in the cockshut light the grass was grey but the dew was white; shadows were dark, and the Sun was gone, the earth-stars shut, but the high stars shone, one to another winking their eyes as they waited for the Moon to rise. Up he came, and on leaf and grass his white beams turned to twinkling glass, and silver dripped from stem and stalk down to where the lintips walk through the grass-forests gathering dew. Tom was there without boot or shoe, with moonshine wetting his big, brown toes: once upon a time, the story goes. |
Il était une nuit, lueur de brune bise, |
Il était une nuit, lueur de brune bise, |
| [30]
[35] [40] |
Once upon a moon on the brink of June a-dewing the lintips went too soon. Tom stopped and listened, and down he knelt: “Ha! Little lads! So it was you I smelt? What a mousy smell! Well, the dew is sweet, so drink it up, but mind my feet!” The lintips laughed and stole away, but old Tom said: “I wish they’d stay! The only things that won’t talk to me, say what they do or what they be. I wonder what they have got to hide? Down from the Moon maybe they slide, or come in star-winks, I don’t know”: once upon a time and long ago. |
Il était une lune au tout début de Juin |
Il était un lune au commencement de Juin |
Enigmes et linets
Ce très beau poème est fort peu connu dans la tradition, mais il appartient visiblement à la même branche : le sujet traité est évidemment bombadilien, et la structure des vers est identique, ce qui nous mène à penser qu’ils sont bien liés. Peut-être est-ce encore une composition du Pays de Bouc, comme les deux précédentes.
Bien qu’il soit plus court, sa traduction ne fut pas plus évidente, l’auteur nous gratifiant même d’une énigme assez ardue : que sont les lintips ? De toute évidence, et du strict point de vue de la construction du nom, un composé de lin et tip ; si la deuxième partie ne pose pas de problème à traduire — extrémité, pointe, bout — la première est plus ardue. Elle n’a pas de sens en anglais moderne, et il faut remonter loin dans l’histoire de la langue pour trouver lin (aussi orthographié linn et lyn). Il viendrait de l’irlandais linn ou du gaélique linne, voisin du gallois llyn, “bassin, étang, lac”, et désignait un bassin — et plus précisément un bassin au dessus ou au dessous d’une chute d’eau[1]. Cette piste est confirmée par la ressemblance avec le lîn sindarin, qui signifie “étang”. Il fallait donc, pour franciser le terme, privilégier cette racine, même s’il semblait peu probable qu’elle fut utilisée dans notre langue… Et pourtant, si : l’actuel lenn breton, qui signifie “marais”, dérive d’un vieux breton lin. Une racine semblable pour un nom aquatique ne pouvait mieux tomber ! Mais il ne fallait pas pousser le vice jusqu’à traduire littéralement par linbout : la sonance n’était pas du tout la même, et il me paraissait tout aussi important de traduire le sens que le symbolisme sonore, cristallin et léger. Le diminutif –et était donc tout indiqué, et linet garde à la fois le double sens et l’évocation sonore. Il ne renseigne pourtant pas sur ce que sont les linets, et nous voilà, tout autant que Tom, réduits aux hypothèses ; car si lui, l’Ancien, l’ignore, lui qui sait tous les noms et tous les chants, lui qui est le Maître, comment pourrions-nous dès lors émettre un jugement péremptoire à leur sujet ? Appartenaient-ils encore au bestiaire des Hobbits au moment où le poème fut composé — sachant que ce moment peut-être très éloigné de celui où il fut retranscrit —, où étaient-ils déjà un simple nom étrange illustrant une légende ? Rien ne nous l’indique, et c’est cette énigme qui ajoute au charme du poème.
Une autre difficulté, à vrai dire, plus une question métaphysique, fut de choisir entre traduire le Soleil et la Lune, ou la Soleil et le Lune. Les genres sont inversés, par rapport au français, dans l’original (sauf au vers 29, ou « moon » perd sa majuscule, et me semble revenir au neutre). Fallait-il, au nom de la lisibilité externe, garder nos genres (Soleil masculin et Lune féminin), ou sacrifier à la tradition (et à la symbolique qu’elle sous-tend) présente dans le poème ? Je n’ai pas encore tranché, les deux aspects présentant autant d’arguments en leur faveur… Les genres du soleil et de la lune sont inscrits dans le nom même en français, par leur terminaison : -eil est masculin (le féminin étant –eille, comme dans corneille), -une féminin (masculin -un, comme dans tribun). De plus, leur genre est culturellement enraciné dans les esprits. D’autre part, la tradition elfique est claire en inversant les genres par rapport à nous, et de toute évidence, c’est cette tradition qui ressort dans l’original, et pas simplement le fait que les Hobbits masculinisent la lune et féminisent le soleil — tout comme les Saxons chez nous : voir l’allemand Der Mond (cf. l’anglais Monday), masculin, et Die Sonne, féminin. Ne pouvant trancher, j’ai laissé les deux versions : au lecteur de choisir celle qu’il préfère.
Quant à la structure même du poème, elle m’a aussi donné du fil à retordre. Chaque strophe commence et finit de la même manière : Once upon a day/night/moon, // Once upon a time. Il était alors obligatoire de conserver ce parallélisme dans la traduction, mais il m’a été impossible de conserver la rime interne des premiers vers de chaque strophe (day/May pour la première, night/light pour la seconde, et moon/June pour la dernière).
[1] Webster’s 1913 Dictionary :
1. \Lin\ (l[i^]n), v. i. [AS. linnan. See {Lithe}.] : To yield; to stop; to cease. [Obs. or Scot.] –Marston.
2. \Lin\, v. t.: To cease from. [Obs. or Scot.]
3. \Lin\, n. [Ir. linn, or Gael. linne; akin to W. llyn a pool, pond, lake, but in senses 2 and 3 prob. from AS. hlynn
torrent. Cf. {Dunlin}.]
1. A pool or collection of water, particularly one above or below a fall of water.
2. A waterfall, or cataract; as, a roaring lin.
3. A steep ravine.
Note: Written also linn and lyn.
(SOURCE : http://www.hyperdictionary.com)