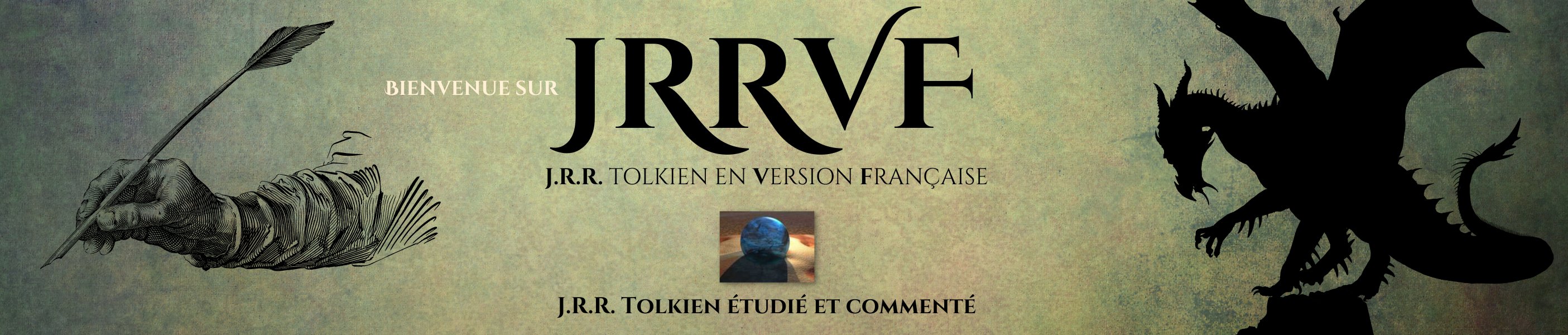Version abrégée de l’article paru dans La Feuille de la compagnie, N°1, les éditions de l’Œil du Sphinx (c) 2001, pp. 200.
Compte rendu de : Flieger (Verlyn) – Hostetter (Carl F.), Tolkien’s Legendarium. Essays on The History of Middle-Earth, Westport – London, Greenwood Press, Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy, n°86, 2000, xvi-274 p.
Comme l’indique l’introduction des éditeurs, ce recueil veut saluer l’achèvement de The History of Middle-Earth (désormais Home) par Christopher Tolkien, à qui le volume est dédié (d’où sa bibliographie par Douglas Anderson en fin de volume, p. 247-252). Sont présentées quatorze études, plus ou moins étendues, émanant pour la plupart de spécialistes bien connus du public, et réunies sous trois chefs : L’histoire, Les langages et Le chaudron et la cuisine (selon la métaphore de Tolkien dans Tree and Leaf, Unwin, 1988², p. 28). Toutes ces pièces sont inédites même s’il faut considérer que le texte de David Bratman reprend des travaux antérieurs (parus dans Mythprint), et que les papiers de John Rateliff et Richard West furent prononcés en différentes circonstances (respectivement lors de la conférence du centenaire – mais le texte n’est pas paru dans le gros volume 80 de Mythlore –, et à l’occasion d’exposés dans les deux Universités du Wisconsin que sont Madison et Marquette).
Table des matières
L’histoire
Cet ensemble s’intéresse principalement au chantier du ‘Silmarillion’. Trois études de fond retiendront l’attention : celle de Scull sur l’importance grandissante des Silmarils, celle de Bratman par son approche générale de l’ensemble littéraire de Home, et le travail de reconsitution par Noad de ce qu’aurait été le Silmarillion si Tolkien l’avait achevé. – Il est échu à Rayner Unwin d’inaugurer les travaux, en revenant sur les “ Early Days of Elder Days ”, texte qui constitue une courte présentation (p. 3-6) du programme éditorial d’ensemble constitué du Silmarillion, des Contes et légendes inachevés et de Home. Bien que puisant dans les archives inédites de la maison d’édition familiale, on y apprend bien peu de choses. L’on reçoit cependant confirmation de ce que tout lecteur de la Préface de (Fr)Home I peut ressentir, à savoir qu’initialement le projet de Home, dont les exigences éditoriales étaient toute commerciales, ne comportait que quatre volumes. – On saura gré à Christina Scull de s’être quasi exclusivement intéressée, dans “ The development of Tolkien’s legendarium. Some Threads in the Tapestry of Middle-Earth ” (p. 7-18), au devenir philologique des Silmarils. Les étapes qu’elle retrace sont d’autant mieux venues que le sujet est primordial pour ce qui justement en est venu à s’appeler le ‘Silmarillion’. Une fois rappelée la façon dont travaillait Tolkien, remettant toujours son ouvrage sur le métier, Scull repart de The Book of Lost Tales où les Silmarils ne sont initialement (dans le manuscrit non effacé de la fin de ‘The coming of the Elves’) que des joyaux parmi d’autres. Tolkien nota qu’il fallait insister davantage sur leur importance (Home I, 169 = FrHome I, 224), ce qui semble fait lorsqu’on les retrouve dans la version révisée de ‘The Tale of Tinúviel’. On ne reparle ensuite, avec Elwing, que du seul Silmaril arraché par son grand-père Beren mais, cette fois, le conte n’est même pas rédigé au brouillon, n’existent que des notes (il faudra encore attendre le Quenta de 1930 pour que le destin céleste de ce Silmaril commence d’être éclairci). Vers 1925, dans le poème inachevé de ‘The Flight of the Noldoli’ (Home III, 134), les Silmarils sont façonnés avant que n’existent le Soleil et la Lune (par la suite, ils leur seront postérieurs), et ils gouvernent alors le destin des Elfes (avant que ce ne soit celui d’Arda toute entière). Leur importance se renforce dans le Sketch de 1926 (Home IV, 14, 17) et l’on sait désormais que l’un finit dans les cieux, un autre dans les mers, le dernier en terre. C’est dans les années trente que les Silmarils passent au premier plan (investissant le titre même du Quenta Silmarillion ou “ The Silmarillion / The history of the Three Jewels, the Silmarils of Fëanor ”, Home V, 202). Dans les années cinquante, Tolkien domine parfaitement le sujet : d’où des textes particulièrement beaux rhétoriquement, ou plus métaphysiques (respectivement Home X, 186-187 et 94-95). Scull souligne bien que le rapport aux deux arbres est délicat tout au long de cette histoire, notamment au moment de l’Ainulindalë C*. – L’étude de Wayne G. Hammond , “ ‘A continuing and evolving creation’. Distractions in the Later History of Middle-Earth ” (p. 19-29), entend montrer que l’œuvre de Tolkien a toujours dû faire face à des contradictions. L’argumentation prend appui sur l’harmonisation, lors des rééditions, du Hobbit avec le Seigneur, ou bien de ces deux œuvres publiées avec le ‘Silmarillion’. Hammond remarque que sur la fin de sa vie, Tolkien entretenait un rapport plus objectif que subjectif à sa propre œuvre. Il l’étudiait et cherchait à en dégager les linéaments philosophiques et théologiques. Les exemples pris par Hammond de l’idée d’un volume spécial de textes techniques (Letters 247-248) et des révisions de l’Ainulindalë (notamment en sa version C*) achèvent de convaincre qu’il ne faut pas toujours chercher pour la Terre du Milieu des réponses définitives, en quelque domaine que ce soit, ainsi qu’il en est dans le monde réel. – Comme son titre l’indique, “ The Literary Value of The History of Middle-Earth ” (p. 69-91), l’étude de David Bratman entend souligner l’aspect littéraire de l’opus posthumus au-delà ou en-deçà du regard habituel d’apports de variantes littérales pour tel ou tel conte. Avant tout, Home livre des textes. Et les textes se doivent d’être lus et appréciés comme tels. Qu’apporte littérairement Home par rapport aux textes publiés du vivant de Tolkien ? L’on y peut distinguer trois styles, que les textes relatifs au premier âge présentent à travers le temps. Si le style antique caractérise The Book of Lost Tales, les premières et les dernières réécritures du ‘Quenta Silmarillion’ peuvent se comprendre comme appartenant au style des annales (Home IV-V et X-XI), tandis que les tout derniers textes ressortissent d’une écriture “ philosophique ” (au sens non technique du terme) dans le style des appendices du Seigneur, des Letters ou des Contes et légendes inachevés (que Bratman considère comme le volume XIII de Home de par le style et la date de composition des textes). Ce style des appendices est aussi celui des ‘Laws and Customs among the Eldar’ et de l’‘Athrabeth Finrod ah Andreth’ (Home X) où la virtuosité littéraire de Tolkien appert peut-être le plus – davantage que dans sa poésie en général. Passant assez rapidement sur les légendes relatives à Númenor (appartenant au style des annales), examinées plus à fond par Rateliff, Bratman envisage encore la sous-série The History of The Lord of the Rings (Home VI-IX, XII). La situation n’étant pas identique, puisqu’il s’agit de se rapporter aux évolutions précédant un texte définitif, cela se répercute sur la delectatio lectionis. Cette étude parcourt donc et distribue habilement les différents versions textuelles des contes et constitue de fait une base solide pour qui veut entrer dans Home, accès d’autant plus facilité qu’est fournie une utile table structurelle de la série (p. 70) et des conseils de lecture par centre d’intérêts (p. 88-89).
L’étude due à Charles E. Noad, “ On the construction of ‘The Silmarillion’ ” (p. 31-68), peut-être la plus importante de ce recueil, s’enquiert du contenu du ‘Silmarillion’ depuis The Book of Lost Tales jusqu’à la fin de la vie de Tolkien. Le relecteur des épreuves de la moitié de la série Home (VII-XII) s’y livre à une enquête (chronologique et systématique) sur l’évolution du ‘Silmarillion’. L’intérêt en est double : d’une part, il retrace les réaménagements successifs du contenu du ‘Silmarillion’, ce qui débouche, d’autre part, sur le plan d’un ‘Silmarillion’ restauré et conforme aux dernières indications connues de J. R. R. Tolkien (même s’il ne voulut sans doute pas l’achever, p. 32). Voici brièvement quelles sont ces évolutions. 1° 1910-1917 : Noad s’intéresse d’abord (p. 33-38) à la question de l’initiative du legendarium (voir Letters 214) : quand Tolkien a-t-il commencé à rédiger quelque chose de ses légendes ? Rappelant l’influence précoce (c. 1911) de la lecture du Kalevala, et ses premières reprises par Tolkien (1912-1914), Noad prend vite au sérieux la déclaration selon laquelle le poème The Shores of Faëry (1915, Home II, 271-273 = FrHome II, 345-346) est le “ premier poème d’[une] mythologie ” structurée (Home II, 271 = FrHome II, 345). Ce serait lui (et non The Voyage of Éarendel the Evening Star, 1914) qui entérinerait la décision, prise lors de la réunion de T.C.B.S. de Noël 1914, de rédiger des légendes pour l’Angleterre (Letters 10). – 2° 1918-1925 : l’examen se concentre ensuite sur les hésitations de The Book of Lost Tales (p. 38-41), i. e. la figure d’Eriol et la place de l’Angleterre (d’où le nouvel envoi de ‘Ælfwine of England’), et sur les lais de Home III. – 3° 1926-1937 : c’est bien avec le ‘Sketch of the Mythology’ (1926) et le ‘Qenta Noldorinwa’ (1930) de Home IV que les choses commencent d’évoluer de manière significative (p. 41-50) concernant notamment le statut de l’Angleterre et la mort de Morgoth. Eriol apparaît toujours alors comme relais de la tradition, même si Rúmil et Pengolodh lui fournirent bientôt le matériau pour les Annales (de Valinor et de Beleriand). Les Annales forment alors les livres II et III du ‘Silmarillion’ (voir Home V, 109-110, 125). Noad passe aussi en revue tous les autres textes de Home V, avant d’en (re)venir à son objet propre : le ‘Silmarillion’ de 1937. Il est alors question de ‘The Quenta Silmarillion’ composé par Pengolod (à partir de travaux de Rúmil) et traduit par Ælfwine. Le plan est indiqué par Tolkien : “ 1 Qenta Silmarillion / to which is appended / The House of the Princes of Men and Elves [= Genealogies] / The tale of years / The tale of the battles [?] ; 2 The Annals of Valinor ; 3 The Annals of Beleriand ; 4 The Lhammas or account of Tongues ” (Home V, 202). C’est de cette période que date l’émergence du titre général de ‘Silmarillion’ comme distinct de celui du Qenta proprement dit. Noad pense que Tolkien aurait ajouté comme appendices à ce ‘Silmarillion’ : l’‘Ainulindalë’, l’‘Ambarkanta’, ‘The Lay of the Children of Húrin’, et ‘The Lay of Leithian’. — 4° 1951-1960 : Tolkien délaisse ensuite le ‘Silmarillion’ pour le Hobbit et le Seigneur. Il y revient dans les années cinquante (p. 50-63, travaillant sur les textes de Home IX-XI). La présence des appendices édités en 1977 (‘Of the Rings of Power’ et ‘Akallabêth’) est autorisée, à partir de 1948 (voir Home IX, 331 et X, 5). a) Un nouveau ‘Quenta Silmarillion’ commence de voir le jour en 1951. Il comprend alors outre le Quenta, les ‘Annals of Valinor’ (bientôt les ‘Annals of Aman’), et les ‘Annals of Beleriand’ (bientôt les ‘Greys Annals’). Au début de cette période, Tolkien est encore attaché à l’idée d’une rédaction par Pengoloð (ou Ælfwine), ce qu’il abandonne ensuite (par exemple avec les ‘Greys Annals’ de Home XI) ; mais Noad considère que le ‘Dangweth Pengoloð’ de Home XII est un texte du ‘Silmarillion’. La lettre 131 à M. Waldman de fin 1951 (?) fournit un plan : la ‘Music of the Ainur’, le ‘Silmarillion’ proprement dit, auxquels sont adjoints les histoires de Beren et Lúthien, des enfants de Húrin, de la Chute de Gondolin, ainsi que celle d’Eärendil, et enfin ‘The Rings of Power’ et ‘Downfall of Númenor’ (voir Letters 146-151). Toute référence à l’Angleterre se trouve écartée à ce moment là. b) A la fin des années cinquante, la division en trois parties est maintenue : le Quenta et deux parties d’Annals, avec traduction par Ælfwine (Home X, 200), mais le statut propre des Annals est alors ambigu : s’agit-il de texte du ou de matériau pour le ‘Silmarillion’ ? Apparaissent encore, à partir de 1958, le ‘Valaquenta’ (au statut semblable à l’‘Ainulindalë’) et ‘Of the Laws and Customs among the Eldar’ (prenant son essor à partir de l’histoire de Finwë et Míriel) puis l’‘Athrabeth Finrod ah Andreth’ (qui devait appartenir au ‘Silmarillion’ puisque le commentaire en est une addition, voir Home X, 329), et ‘Quendi et Eldar’ (au statut incertain, voir Home XI, 359). Tolkien envisageait encore que les grands légendes (Beren et Lúthien, les enfants de Húrin, et La Chute de Gondolin) appartinssent au ‘Silmarillion’ au titre d’appendices (voir Home X, 373). Deux questions agitent ces rapports par Noad sans que l’on puisse, nous semble-t-il, statuer de façon satisfaisante : celle de la vision du monde de l’‘Ainulindalë’ et de l’‘Ambarkanta’ (monde plat ou rond), et celle du “ rédacteur ” du ‘Silmarillion’. Les prétendants se nomment Eriol, Ælfwine, et les différents Pengolod (pour faire bref : Pengolodh avant 1937, Pengolod à partir de 1937 mais Pengoloð dans les années 50). Mais Noad mentionne encore, avant de conclure en résumant son propos (p. 63-68), une note investissant définitivement (?) Bilbo dans ce rôle de scribe du ‘Silmarillion’ (Home XII, 14) ! Ressort finalement le plan d’un ‘Silmarillion’ restauré comprenant outre 1° le Quenta, trois grandes sections (2°, 3° et 4°) et des appendices (5°). Les grandes sections regroupent d’abord (2°) ce qui concerne les Puissants (à savoir l’‘Ainulindalë’ et le ‘Valaquenta’), ensuite (3°) les grandes légendes (‘The Lay of Leithian’, ‘Narn i Chîn Húrin’, ‘The Fall of Gondolin’, ‘Eärendel the Wanderer’), et enfin (4°) les dernières légendes (‘Akallabêth’ et ‘Of the Rings of Power’). (5°) Les appendices, quant à eux, comprendraient : ‘The Tale of Years’, ‘Of the Laws and Customs among the Eldar’, ‘Dangweth Pengoloð’, ‘Athrabeth Finrod ah Andreth’, et ‘Quendi and Eldar’). Cette reconstitution, qui s’avoue bien en reste d’indiquer quels textes suivre pour en réaliser le projet, suppose d’une part que Tolkien n’ait jamais voulu qu’enrichir le ‘Silmarillion’ sans rien abandonner (ce qui est problématique pour les Annals), ou pour le dire autrement, qu’il y ait une unité d’intention dans les travaux des années 50.
Langages
Cette section est la plus modeste avec trois articles seulement. Les quatre auteurs sont engagés dans un programme de transcription et d’édition des nombreux papiers linguistiques encore inédits de Tolkien. – Christopher Gilson veut élucider et exhiber la justesse de la célèbre identification, par Christopher Tolkien, selon laquelle “ Gnomish Is Sindarin : The Conceptual Evolution of an Elvish Language ” (p. 95-104). Le sens de cette identification est de dire que le gnomique des Noldor du Livre des Contes Perdus a survécu dans le Sindarin des Elfes-Gris de Beleriand (à raison de 10% du vocabulaire et 40% des noms propres). Gilson, éditeur, en 1995, du Gnomish Lexicon ou I·Lam na·Ngoldathon comme volume 11 de Parma Eldalamberon, commence par dresser la liste des vocables reconnaissables par le lecteur du Seigneur et du Silmarillion (p. 96). Cette transmission passe en 1937 par le Noldorin des Etymologies (Home V). Certains termes sindarins peuvent s’inférer d’anciens termes gnomiques dont le sens s’est légèrement déplacé, d’autres ont connu des altérations phonétiques, parfois les deux phénomènes interviennent. Si l’on quitte l’orthographe pour la grammaire, l’on parvient aux mêmes conclusions, notamment en étudiant le devenir des suffixes, du génitif et des noms finissant par une voyelle (p. 100 sqq.). – Arden R. Smith, “ Certhas, Skirditaila, Fuþark. A Feigned History of Runic Origins ” (p. 105-111), rappelle d’abord que rune signifie mystère (lequel se loge avant tout dans l’origine même de ces signes), et souligne que les valeurs des runes du Seigneur ne sont pas celles du fuþark germanique. D’ailleurs, l’origine des runes est chez Tolkien bien connue : les Sindar de Beleriand, et Dairon en particulier. Mais les runes utilisées dans le Hobbit sont anglo-saxonnes. Y aurait-il donc deux systèmes runiques indépendants en Terre du Milieu, dont l’une sans aucune liaison avec les runes historiques ? S’appuyant sur l’‘Alphabet of Dairon’ (Home VII, 454 sqq.) de 1937, Smith envisage les problèmes posés par l’assignation d’une origine mythologique béleriandienne au fuþark via le skirditaila. – Comme son titre l’indique, l’article bicéphal de Patrick Wynne & Carl F. Hostetter, “ Three Elvish Verse Modes : Ann-thennath, Minlamad thent / estent, and Linnod ” (p. 113-139), tâche d’éclaircir le sens des trois modes poétiques usités en sindarin. L’ann-thennath, signalé par Tolkien dans la Communauté de l’anneau (LoR I, 205 = SdA 219, éd. Bourgois compacte), signifie que les syllabes sont “ longues et courtes ”, comme dans le iambique en grec. Il s’agit de l’usage le plus courant dans la versification sindarine, cependant nous ne disposons pas de poème en sindarin suivant ce mode, uniquement des traductions. L’alternance long/court est peut-être aussi celle des vers masculins (à quatre syllabes) et des féminins (à trois syllabes). Suit l’étude des rimes. On ne connaît pas non plus d’exemple de minlamad thent / estent, autrement dit “ allitération [avec unité] longue / courte ”. On apprend, en Home XI, 311-312, que le Narn a été traduit en anglais par Ælfwine, à partir d’un poème en minlamad thent / estent composé par Dírhavel. Ce mode se prête davantage au parler qu’à la chanson. En cela, il obéit au modèle des vers allitératifs en vieil anglais que Tolkien pensait sans rythme et sans mélodie avant que Pope n’exhibe The Rythm of Beowulf (1942). Cela n’induit pas forcément la chanson, de même que, chez Tolkien, la mention éventuelle de la harpe d’un ménestrel (Home V, 87) n’est pas synonyme de chant (voir encore Home IX, 271-272 avec la transposition de sing par recite). Ce n’est qu’à partir de 1955 que Tolkien pensa qu’ils étaient chantés (à la différence du mode elfique donc). Enfin, le linnod (littéralement le “ chant des sept ” syllabes), dont Tolkien parle dans l’Appendice A (V) du Seigneur (LoR III, 342 = SdA 1134), a l’avantage sur les deux précédents d’être analysable grâce à un exemple en sindarin. Il est utilisé pour exprimer des aphorismes. Ne disposant que d’un exemple, on peut dire si tout linnod est de forme allitérative ou non. En appendice (p. 133), cet article donne les scansions des cinq poèmes actuellement publiés en sindarin. L’abondante annotation montre que ces analyses sont basées sur les indications de The Road goes ever on, les remarques des travaux sur Beowulf ou Sir Gawain, les indices de The Lost Road et The Notion Club Papers, ainsi que des enregistrements par Tolkien de ses textes.
Le chaudron et la cuisine
Après l’étude des langues viennent six articles plus littéraires, au sens strict du terme pour les deux premiers (Christopher et Thomas). Ceux de Flieger et Rateliff peuvent s’articuler quant à eux autour de The Lost Road et The Notion Club Papers. Les deux derniers (Burns et West) rapportent Tolkien à la littérature nordique. – Nous quittons donc l’elfique, mais non la poésie avec l’article de Joe R. Christopher, “ Tolkien’s Lyric Poetry ” (p. 143-160), qui s’attache à l’analyse spécifique de quatre poèmes (sur les quelques soixante-quinze compris dans Home) : le sonnet, de 1915, ‘Kôr : In a City Lost and Dead’ (Home I, 136 = FrHome I, 181-182), au style antique et de forme ABABCDCDEEFGGF ; l’allitératif ‘Winter comes to Nargothrond’ (Home III, 129) dont la première version date de 1924-1925 (Home III, 127, cf. 81) qui ne fait que décrire la venue de l’hiver ; le lyrique ‘Light as Leaf on Lindentree’ (Home III, 108-110, 120-121 et LoR I, 187-189, éd. Harper en un volume = SdA 217-219) de 1924-1925 également, de forme ABACBABC, qui présente un amour idéalisé entre Beren et Lúthien, c’est-à-dire entre un mortel et une elfe (lisible comme le rapport d’un artiste à sa muse) ; mais c’est surtout ‘The Death of St. Brendam’ (Home IX, 261-262, 296-299) qui retient l’attention de Christopher, qui relève le fait que dans The Notion Club Papers, ce poème est attribué à Frankley, c’est-à-dire à C. S. Lewis (qui reprendra ce thème dans ses Chroniques de Narnia quelques années plus tard). Les deux versions de ce poème, sur lequel le travail a dû commencer en 1946, se distinguent par leur style respectif. On y remarquera que les elfes sont identifiés à des oiseaux. Christopher, après avoir rapproché les vers de Tolkien concernant saint Brendam (personnage historique, irlandais fondateur du monastère de Clonfert en 559) de ceux que lui consacra Lord Tennyson, tente une approche de sa signification théologique. Finalement, il apparaît que tous ces poèmes relèvent du style romantique. Cette étude, s’attachant à la valeur purement poétique des pièces tolkieniennes, nécessite un bon bagage technique. Elle n’est, de ce fait et sur bien des points, accessible qu’aux anglophiles avertis. – Avec Paul Edmund Thomas, nous comparons “ Some of Tolkien’s Narrators ” (p. 161-181), en l’espèce celui du Hobbit et son devenir dans le Seigneur des Anneaux. Après la reprise des concepts de Booth dans The Rhetoric of Fiction (Chicago, 1983²) considérant comme plus ou moins ‘intrusif’ un narrateur selon qu’il révèle et interprète l’histoire, et qu’il en est aussi plus conscient, Thomas examine celui du Hobbit qui se découvre, dès le premier chapitre, comme interprète, révélateur circonspect choisissant de ne pas livrer tout son savoir au lecteur, ce qui suggère donc qu’il est tout à fait conscient (des enjeux) de l’histoire qu’il raconte. Thomas souligne encore d’autres caractéristiques du narrateur du Hobbit, comme a) les adresses directes au lecteur (dont l’appendice, p. 180, dresse la liste – soulignant au passage qu’elles n’ont pas disparu des éditions de 1951 et 1966, ce qui donne tort à Carpenter (Tolkien. Une Biographie, Pocket, p. 200) lorsqu’il dit que Tolkien en supprima beaucoup) ; b) le passage inattendu d’un personnage à un autre et c) son côté reporter impartial des faits. Vient ensuite l’étude de l’évolution du statut du narrateur dans le chapitre inaugural du Seigneur cette fois (ce qui est d’autant plus pertinent que les titres de ces chapitres sont très voisins et que Tolkien, dans la lettre 131 en a souligné le parallélisme voulu), principalement d’après les cinq versions préparatoires (Home VI), et la version publiée. Dans les versions préparatoires, on découvre d’abord un narrateur en apparence semblable à celui du Hobbit, mais ignorant (notamment des détails du Hobbit) dans la première version, puis de correction en correction, Tolkien tourne cette ignorance (devenue superficielle et feinte) en ironie. Finalement, la version publiée supprime l’ironie au profit d’un rapport impartial des faits. Cette caractéristique secondaire dans le Hobbit passe donc au premier plan dans le Seigneur, au point d’éclipser les caractéristiques intrusives de son narrateur : si quelques remarques interprétatives demeurent, les adresses directes ne se rencontrent plus. Ces évolutions s’expliquent, selon Thomas, par le fait que cette dernière version a été rédigée lors de la seconde phase du Seigneur, c’est-à-dire lorsque Tolkien était déjà avancé au ch. 12 et savait la tournure qu’allait prendre l’histoire, d’une part, et par le fait que le ‘Silmarillion’ avait fait évoluer l’écriture de Tolkien d’autre part. Cette évolution peut déjà se lire au sein du Hobbit, les six derniers chapitres ne comportant plus d’adresses directes…
Verlyn Flieger, dans son article “ The Footsteps of Ælfwine ” (p. 183-198), se focalise sur la détermination du nom Ælfwine (littéralement l’ami des elfes) en Terre du Milieu comme espèce d’identité ou signe d’élection pour une communauté spécifique (regroupant notamment Húrin, Túrin, Beren, Bilbo, Frodo) dans le Seigneur des Anneaux. Home permet d’en approfondir le concept. Nous y rencontrons en effet Ælfwine (=) Eriol dans The Book of Lost Tales (Home I-II), Elendil = Alboin Errol dans The Lost Road (Home V), Alwin Lowdham, fils d’Edwin dans The Notion Club Papers (Home IX), qui sont autant d’amis des elfes. Ils ont pour premier dénominateur commun de mettre en relation le monde réel avec la Faërie par un lien avant tout narratif. L’ami des elfes, en appartenant aux deux mondes, est mieux placé qu’aucun autre pour transmettre les légendes : c’est un vrai médiateur. Les légendes de Faërie n’existent que parce qu’elles ont été ainsi transmises. Flieger analyse donc ensuite ces personnages pour en découvrir d’autres caractéristiques. Elle rapproche Eriol, de The Book of Lost Tales, aussi appelé l’Anglais (Angol) par les gnomes, et qui s’appelait lui-même Wæfre, le voyageur, du Gangleri de l’Edda en prose : tous deux transmettent les légendes, et (se) posent les mêmes questions. L’ami des elfes a donc d’abord pour fonction essentielle de relier en témoignant de ce qu’il a entendu ou vu (Alboin comme Lowdham assistent à la chute de Númenor). Cela débouche, ensuite, sur la rédaction d’un livre dans le cas d’Eriol et d’Elendil (Home IX, 279) comme pour Bilbo (dont le “ Livre Rouge de Westmarch ” emprunte son titre courant au Red Book of Hergest, conservé à Jesus College, Oxford, qui rapporte les légendes galloises). Poursuivant justement la recherche des figures de l’ami des elfes, Flieger découvre, enfin, l’importance de la descendance : Frodo continua la rédaction du “ Livre rouge ”, ou Smith suivant son grand-père Master Cook dans Smith of Wootom Major (ou encore Home IX, 278-279). Il est d’ailleurs remarquable que Tolkien lui-même se pense comme (un tel) passeur de relai (Letters 145) : il est l’ami des elfes que l’on suit toujours. – Dans “ The Lost Road, The Dark Tower, and The Notion Club Papers. Tolkien and Lewis’s Time Travel Triad ” (p. 199-218), John D. Rateliff s’intéresse tour à tour à l’origine et l’inachèvement des deux séries de récit de voyages dans le temps de Tolkien et Lewis. Il insiste notamment sur la proximité originelle de leurs premiers projets (repérable jusque dans le vocabulaire : Elwin/Ælfwine, Tor-Tinidril/Tuor-Idril et Numinor/Númenor). La discussion entre Lewis et Tolkien débouchant sur la répartition des voyages spatiaux et temporels, qui a dû avoir lieu en 1936 lorsque tous deux n’avaient encore que très peu publié, constitue alors un projet nouveau encouragé par la lecture de Williams et Lindsay. Après la chute de Númenor, l’accès à Valinor n’est plus direct, la route est perdue, et seuls les voyages temporel et aussi spatial permettent d’y revenir : Tolkien et Lewis l’affirment de concert (The Lost Road, Home V, 1 et la dernière phrase du post-scriptum de Out of the Silent Planet). Mais Tolkien, à la différence de Lewis, ne terminera pas son voyage (mais aidera Lewis à être publié). Il y a à cela des raisons externes et internes. L’achèvement du Hobbit y est notamment pour beaucoup. Et même si lorsque Tolkien soumet The Lost Road à son éditeur, l’ébauche est jugée prometteuse, le succès n’est pas évident pour R. Unwin comme il l’est pour “ la suite du Hobbit ”. Rateliff, puisant dans les archives Unwin, montre que Tolkien a reçu cet avis quelques jours après qu’il ait effectivement commencé d’écrire le Seigneur. L’histoire ultérieure de The Notion Club Papers (rédigé entre fin 1944 et août 1946 et empêché cette fois par l’achèvement du Seigneur) et de The Dark Tower de Lewis est similaire. Ces projets s’inscrivent communément à la suite de Out of the Silent Planet, Tolkien sous-titrant même son voyage ‘Out of the Talkative Planet’. Rateliff fait remarquer que Tolkien est le seul à attester la paternité de The Dark Tower à Lewis lorsqu’il parle d’une “ histoire concernant les descendants de Seth et Cain ” (Letters 105), et avance neuf arguments allant dans le sens de cette attribution, malgré certains problèmes de datation, avant de spéculer sur son inachèvement (l’abandon de la science-fiction due à la mauvaise réception de Cette hideuse puissance et l’orientation vers la fantaisie de Narnia). Cet article, suscité par le centenaire, est remarquablement documenté historiquement. On regrettera seulement que la bibliographie n’en soit pas actualisée : le livre de V. Flieger, A question of Time, paru en 1997, n’est pas mentionné.
Avec “ Gandalf and Odin ” (p. 219-231), Marjorie Burns nous propose un travail allant au-delà d’un simple parcours d’un aspect dans Home. Elle entreprend en effet de rapprocher certains personnages de la Terre du Milieu (Morgoth, Sauron, Saruman, Gandalf et Manwë) avec un autre personnage appartenant à la littérature traditionnelle nordique (Odin), ce à quoi Christopher Tolkien avait dû renoncer, le contraire ayant considérablement alourdi sa tâche. Reste cependant que, puisque les textes sont accessibles dans Home, ce genre de travail se doit désormais d’être entrepris et affiné par les commentateurs. En effet, Burns rappelle d’abord que deux générations de critiques (Ryan, Green, et St. Clair en 1969-1970, puis Noel, Flieger et Brunsdale à partir de 1977-1978) avaient déjà vu le rapprochement entre Odin, Sauron et Gandalf par les seules lectures du Hobbit et du Seigneur. L’attention aux aigles, au cheval (cf. Shadowfax), et à leurs allures et jusqu’à l’œil de Sauron en avait facilité la reconnaissance. Burns renforce ensuite, en s’appuyant sur Home, ces premiers rapprochements et en propose de nouveaux : Saruman et surtout Manwë et même Morgoth sont aussi des figures d’Odin. Ainsi, en Home II, 290 (= FrHome II, 370), Manweg (Manwë) est-il associé à Woden (Odin). La dualité d’Odin est toujours scindée chez Tolkien : Manwë relayé ou représenté par Gandalf vs. Morgoth relayé par Sauron, ou l’opposition Gandalf/Saruman. – Richard C. West, dans “ Túrin’s ofermod ” (p. 233-245), propose tout d’abord de rapprocher le sens de l’origine du nom Tolkien (Letters 218) d’un mot de vieil anglais de The Battle of Maldon : ofermod. West envisage, dans un premier temps, l’interprétation de Tolkien (telle qu’on peut la lire à travers sa représentation de Beorhtnoth) parmi celles des autres spécialistes de vieil anglais. Comment concevoir l’ofermod ? S’agit-il de courage admirable ou d’une condamnable témérité ? Cette tension entre les lectures de l’ofermod, que les premiers critiques (tels Britton, Indestege, ou Wilson dès 1953) avaient envisagée, West la retrouve et l’étudie à nouveaux frais, en un deuxième moment, avec Túrin. Rappelant que cette geste, la première composée par Tolkien, doit beaucoup de son aveu même au Kalevala (chants 31-36), West résume l’histoire de Kullervo en soulignant les similitudes. Si l’idée d’une épée magique parlante par laquelle le suicide a lieu provient bien du Kalevala, la séparation de l’enfant de ses parents, et l’inceste ultérieur pourrait aussi provenir de la Völsungasaga qui fournit aussi avec Sigurd et Fáfnir un modèle pour Túrin et Glorung. Mettant à plat chronologiquement les différentes versions principales de ‘Túrin’ dans toute l’œuvre (que ce soit dans Home II-III, IV-V, X-XII, les Contes et légendes inachevés et le Silmarillion), West compare finalement‘Turambar and the Foalókë’ et le ‘Narn i Hîn Húrin’ des Contes et légendes inachevés, soulignant que si Melian qualifie Túrin d’“ over-bold ” (que Jolas rend en français par présomption), c’est-à-dire l’ofermod vieil anglais, c’est après le renforcement de son trait de caractère orgueilleux. West le relève par sept fois. Avec Túrin, Tolkien travaille donc à la limite de l’héroïsme.
Bref, on appréciera cette initiative de Flieger et Hostetter de saluer, prendre en compte, et parcourir de telle manière la totalité de Home (bien que les volumes VI-IX soient moins étudiés), chose qui n’est pas encore monnaie courante, surtout dans les commentaires francophones – faut-il le préciser et l’avouer ? Le volume comprend un index d’une quinzaine de pages, chaque article présente une bibliographie. La facture générale est de très belle tenue (quelques coquilles départissent l’ouvrage, une liste d’errata est disponible en ligne). Greenwood Press annonce pour fin juin 2000 un autre volume comprenant treize articles sur J. R. R. Tolkien and his Literary Resonances. Views of Middle-Earth, édité par G. Clark et D. Timmons, qui prolongera la dernière section de ce recueil-ci.
Michaël Devaux,
© La Compagnie de la Comté – Les Editions de l’Œil du Sphinx