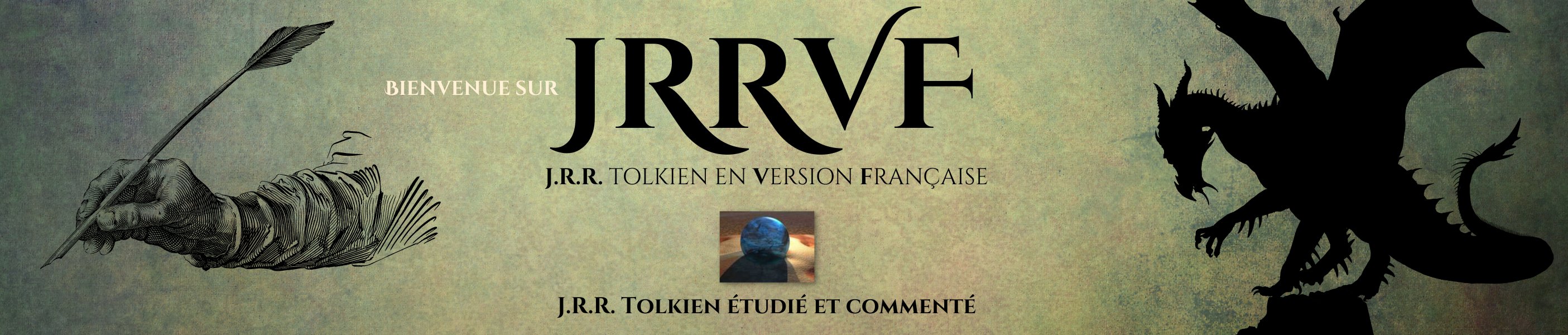Il est convenu d’appeler « cycle arthurien » une série d’oeuvres qui, à partir du IXe siècle, présentèrent l’histoire de la Grande-Bretagne et les aventures de sa classe noble et guerrière à l’époque d’un roi moins historique que légendaire et qui s’appelait Arthur. Le « cycle » n’est donc pas l’oeuvre d’un seul auteur, mais celle de nombreuses générations d’écrivains qui n’ont cessé d’ajouter au « corps » arthurien leur contribution soit romanesque, soit pseudo- historique. Des textes latins, français, provençaux, hispaniques, italiens, gallois, anglais, allemands, tchèques, russes et bien d’autres – il serait fastidieux de prolonger la liste – conservent le souvenir du roi fabuleux des Bretons et de ses chevaliers de la Table ronde. La floraison de la légende arthurienne – phénomène vraiment européen – appartient au Moyen Âge, mais cette littérature est loin d’être morte : bien au contraire, elle inspire le roman, le théâtre, la poésie et même le cinéma du XXe siècle.
Le roi Arthur a-t-il existé ? Un personnage nommé Arthur est cité pour la première fois dans l’ Historia Britonum , que composa Nennius vers le début du IXe siècle. Il aurait été vainqueur dans une douzaine de batailles, et cependant la partie arthurienne de l’ Historia de Nennius tient en une quarantaine de lignes. L’auteur le décrit comme un Britannique qui occupait une place éminente dans la société militaire, à l’époque qui suivit le départ des Romains. Ce dux bellorum, pour reprendre le terme de Nennius, était déjà certainement très connu à l’époque.
La matière historique
Les thèmes de Nennius avaient déjà été traités au milieu du VIe siècle par Gildas dans son De excidio et conquestu Britanniae . Ce sont donc des événements historiques auxquels Nennius fait allusion. Il précise que la douzième bataille où triompha Arthur se déroulait in monte Badonis . Cependant, grâce à Gildas – qui ne cite pas le nom du roi Arthur – nous savons que ces événements eurent lieu le mois et l’année de sa propre naissance, c’est-à-dire vers la fin du Ve siècle. Nennius précise en outre que dans le pays d’Arthur se trouvaient des curiosités remarquables, dont « Cain Cabal », une pierre où l’on voyait l’empreinte de la patte de Cabal, le chien d’Arthur, et « Licat Anir », le tombeau d’Anir, le fils d’Arthur, tué par son père. Les dimensions de ce tombeau variaient : un jour il avait six pieds de longueur, un jour neuf, un autre jour douze et parfois quinze pieds.
Les annales, par exemple les Annales Cambriae – ce sont, en effet, des Annales, ou Tables pascales -, font mention d’Arthur et de Medraut ; il y eut au cours de ces campagnes, en Bretagne et en Irlande, de nombreux morts.
C’est à Geoffrey de Monmouth, évêque de Saint-Asaph, petite ville de la Galles du Nord, que revient l’honneur d’avoir lancé la vogue de la légende arthurienne. Son Histoire des Rois de la Grande-Bretagne donne une place importante au roi légendaire. Geoffrey raconte la conquête d’Albion, les règnes des rois britanniques que vainquirent les Romains. Suivent l’histoire de la famille de Constantin et celle d’Arthur, pour terminer avec la conquête des Saxons. Non sans s’inspirer de la manière de Virgile, Geoffrey écrit l’histoire de la Bretagne en composant des récits qui expliquent l’étymologie des noms de lieu – ainsi Leicestre est la ville ( castra ) du roi Leir, que Shakespeare devait rendre célèbre. Dans la partie arthurienne de l’ouvrage, Geoffrey raconte la conception et la naissance d’Arthur, fils adultérin d’Uther et d’Iguerne, femme du duc de Cornouailles. À l’âge de quinze ans, Arthur est couronné à Silchester et défend son royaume contre les Saxons. Puis il est couronné roi des Pictes (les Écossais), des Gaulois et, enfin, des Romains. Rappelé en Bretagne par la trahison de Mordred, qui s’est emparé de la couronne et a enlevé la reine Guenièvre, Arthur rejoint Mordred ; ils se battent près de la rivière Camlan. Mordred est tué, Arthur est transporté à Avalon et ces événements, qui marquent la fin de son règne, sont à situer, selon Geoffrey de Monmouth, en l’an 542.
On le voit, c’est Geoffrey qui fait d’Arthur le dux bellorum de la vieille tradition, un roi et même l’empereur de l’Europe. Avant de rédiger son Historia , Geoffrey avait déjà esquissé le récit de ces événements dans ses Prophéties de Merlin , qui occupent actuellement le livre VII de l’ Historia . Arthur devient le chef d’une cour, d’une civilisation même, qui éclipse les cours rivales. Les principaux événements de son règne sont marqués par des guerres et des conquêtes qui n’excluent pas l’éclat ni le faste des cérémonies. Arthur lui-même y joue un rôle actif, il dirige les campagnes et affronte ses ennemis en combat singulier.
Ce texte connut un succès immédiat. Composé en 1137, il fut copié et recopié. Un manuscrit se trouvait avant 1154 au Bec, et les quelque deux cents exemplaires qui existent encore aujourd’hui ne représentent qu’une faible proportion de la totalité des copies faites au Moyen Âge. Le thème était britannique, ce qui n’empêcha pas tout un public européen de réclamer d’autres versions de la même histoire, où se retrouvait cette île mystérieuse et couverte de brumes que les guerriers normands venaient de conquérir.
Il existe des versions anglaises, galloises, de Wace. Son Roman de Brut marque un tournant dans l’évolution du cycle arthurien. En choisissant la langue française, langue du peuple, Wace a voulu offrir l’histoire de Brutus, fondateur de la « Bretagne », à un public plus étendu. Il y ajouta, à titre exemplaire, l’histoire de la « Table ronde » qu’institua le roi Arthur pour mettre fin aux querelles de préséance de ses chevaliers. Wace place son roman dans le cadre qu’a déjà dressé Geoffrey de Monmouth. C’est l’histoire de la Bretagne depuis les origines jusqu’à l’époque des Saxons, mais la place prépondérante y est réservée au règne d’Arthur. Les descriptions de sa cour, des guerres et des cérémonies évoquent la vie des nobles au XIIe siècle, et non celle d’une époque bien antérieure. Le Brut de Wace connut une popularité considérable ; une adaptation anglaise par le poète Layamon s’ajoute au témoignage qu’offrent les nombreuses copies de son oeuvre.
La tradition littéraire
Wace
Le Roman de Brut sert de pont entre la matière historique et la littérature médiévale. Wace, dont la source est l’ Historia , écrivit un « roman ». C’est à la psychologie de ses personnages qu’il s’intéresse d’abord. Ainsi, l’histoire de la conception du roi Arthur devient ici un roman d’amour. C’est parce qu’il est épris d’Iguerne qu’Uther demande conseil à Merlin qui l’aidera à accomplir ses désirs : Arthur est né de l’union coupable d’Uther et d’Iguerne. Wace explique tout par l’amour, et s’attarde à décrire les noces du couple amoureux. Il introduit les noms de maints chevaliers arthuriens, mais il n’entre pas dans le détail de leurs aventures. Quand il décrit la cour splendide qu’Arthur réunit à Caerlon-sur-Usk, Wace précise qu’à cette époque la période de paix dura douze ans. Une douzaine de vers suffisent pour indiquer que les chevaliers vécurent alors une suite d’aventures extraordinaires. Mais Wace préfère décrire la vie guerrière : il passe sous silence les aventures romanesques et surnaturelles des compagnons de la Table ronde.
Chrétien de Troyes
« L’oeuvre de Chrétien de Troyes est un confluent où s’unissent les principaux courants de son époque », dit Jean Frappier. Ce n’est donc pas lui, comme on l’a souvent avancé, le créateur du roman arthurien. Si Chrétien n’a pas inventé le thème arthurien, il y a apporté un souci nouveau ; il a voulu créer une oeuvre d’art ; il s’en prend aux mauvais conteurs et proclame, au début de son roman Érec et Énide , qu’il a l’intention de transformer un « conte d’aventure » en une « moult belle conjointure ». Ses romans bretons, ou arthuriens, sont au nombre de cinq : Érec et Énide , Cligès , Lancelot, ou le Chevalier de la charrette , Yvain, ou le Chevalier au lion et, enfin, Perceval, ou le Conte du Graal .
Les problèmes que pose la chronologie de ces oeuvres sont des plus délicats. Selon Anthime Fourrier, Érec aurait été composé aux alentours de 1170, Cligès vers 1176, Yvain et Lancelot , composés plus ou moins simultanément, datent de 1177-1181 ; le Conte du Graal fut commencé après le 14 mai 1181. Chrétien travailla d’abord à la cour de Marie, comtesse de Champagne et fille d’Aliénor d’Aquitaine. C’est pour elle qu’il rédigea le Lancelot . Le mécène pour qui il commença le Conte du Graal fut Philippe d’Alsace, comte de Flandre. Ce dernier roman reste inachevé ; sa composition fut sans doute interrompue par la mort de Chrétien.
Le point de départ des romans de Chrétien, c’est la cour du roi Arthur. Au début de l’ Érec , les chevaliers d’Arthur sont partis à la chasse, et c’est Érec qui se trouve en compagnie de la reine quand le nain d’Yder, le fils de Nut, se présente pour l’insulter. Le Lancelot débute par l’épisode où un robuste chevalier, Méléagant, fils du roi Baudemagus, vient enlever la reine. Yvain, à son tour, quitte la cour pour pénétrer dans la forêt de Brocéliande. Perceval, lui aussi, dirige enfin ses pas vers la célèbre cour des Bretons, tout comme l’a déjà fait Alexandre, le père de Cligès. Mais, à vrai dire, le roi Arthur ne joue dans ces romans qu’un rôle insignifiant. Il évoque un peu les rois fainéants de la France mérovingienne. Chrétien met en scène des héros d’un caractère différent. Certes, ils sont chevaliers, mais combien moins vigoureux que les douze pairs de Charlemagne ou que les vassaux d’Arthur que nous avons connus chez Geoffrey de Monmouth ou chez Wace. Les héros de Chrétien sont déjà des individus, et c’est à leur vie privée que l’auteur s’intéresse. Chrétien ajoute au cycle arthurien non seulement l’épopée de Byzance, mais aussi le roman d’amour. L’état d’âme et la vie amoureuse des héros (et des héroïnes) sont, pour Chrétien, au moins aussi importants que leurs exploits guerriers. Chacun de ses romans pose un problème sentimental et courtois. Ayant conquis son épouse Énide, Érec ne parvient pas à établir la balance entre les devoirs de l’amour et ceux de la chevalerie. Il part avec Énide à la recherche d’aventures parfois mystérieuses, mais surtout à la recherche de l’état d’harmonie du couple dans la société. L’apothéose n’est pas le mariage des jeunes époux, mais la « joie de la Court » et le couronnement d’Érec et d’Énide à Nantes.
Avant d’aborder le problème de Fenice, mariée à un homme qu’elle n’aime pas, mais amoureuse de Cligès, Chrétien raconte, dans le premier tiers du roman, l’histoire des parents de celui-ci. Là, il renouvelle le célèbre jeu de mots d’Ovide où le « mal d’aimer », ce « mal amer », n’est pas compris : on croit que les amants souffrent de « mal de mer » ( mare , amare , amarum ). Marie de Champagne donna à Chrétien le « sens » et la « matière » de son Lancelot . Cette fois, le mariage n’est pas la consommation de l’amour ; il est un obstacle. Guenièvre, la femme du roi Arthur, éprouve une passion coupable pour Lancelot, le chevalier qui, pour délivrer sa bien-aimée, monte dans la charrette infâme. Mais leur amour n’a rien de platonique. En nous décrivant la nuit que Lancelot et Guenièvre passent ensemble, Chrétien souligne seulement que l’amour courtois est à la fois amour spirituel et amour charnel.
Chrétien de Troyes n’était pas assuré de sa doctrine sur l’amour. Dans son Yvain , il reprend le thème de l’amour qui trouve son épanouissement dans le seul mariage. Et même, chassé par son épouse, le héros perd la raison. Cependant, à la fin du roman, Yvain et sa femme se trouvent réunis. Pour l’auteur, tout est dit.
Son dernier roman, écrit pour le comte de Flandre, nous raconte la vie d’un orphelin gallois. Élevé par sa mère dans la forêt, il se rend, contre son gré, à la cour d’Arthur. Le fier jeune homme y apprend l’étiquette de la civilisation courtoise. C’est dans ce roman que Chrétien introduit le thème du Graal, mystère religieux qu’il effleure seulement. Nous ne connaîtrons jamais le sentiment de Chrétien sur cette sainte allégorie, car la mort vint interrompre son oeuvre.
On le voit, pour Chrétien, c’est à la cour du roi Arthur que naissent les aventures des chevaliers dont les noms lui ont été donnés par ses devanciers. Grâce au poète champenois, le cycle arthurien prend un aspect nouveau, un rythme plus ferme. Ajoutant à l’analyse de l’amour un goût pour l’aventure et pour le merveilleux, Chrétien a fourni une immense contribution à la littérature. Les guerres, les combats, les événements historiques sont subordonnés à l’étude de sentiments exquis dans un milieu courtois. Cependant les épisodes extraordinaires ne manquent pas ; les chevaliers pénètrent jusqu’aux confins de l’Autre Monde (Lancelot dans le royaume de Gorre, Érec à la joie de la Court), d’autres se battent avec des géants ou des bêtes sauvages (Yvain vient au secours d’un lion attaqué par un serpent), d’autres encore ont des aventures prophétiques et symboliques (Lancelot au Cimetière périlleux, ou traversant le Pont de l’Épée), mais Chrétien nous ramène toujours au monde familier et réel du XIIe siècle. Même les aventures les plus étranges ont leur côté familier : au château de Pesme Aventure, Yvain délivre de jeunes captives et se bat contre deux monstres ; là aussi, le héros passe des moments délicieux dans un verger, où la fille du seigneur, un livre à la main, lit à haute voix un roman à son père et à sa mère. Dans cette scène de la vie quotidienne, avec une adresse pleine de charme, Chrétien évoque les plaisirs intellectuels de la société pour laquelle il composait ses oeuvres.
Les successeurs de Chrétien : les romans en prose
Vers la fin du premier quart du XIIIe siècle, un auteur anonyme propose à ses contemporains une vaste série de romans arthuriens, écrits en prose, et qui mérite bien le titre de « cycle arthurien ». Ce cycle, dit « Vulgate », ou Lancelot-Graal , retrace l’épopée du royaume d’Arthur depuis ses origines jusqu’à la chute de ce petit univers civilisé qu’était la Table ronde. Divisé en cinq sections principales, il ajoute à l’histoire légendaire de la Bretagne maint épisode romanesque où les chevaliers errants partent à la recherche des aventures du royaume de Logres. Le centre de ce cycle, c’est le Livre de Lancelot du Lac , appelé par les savants le Lancelot propre . Le héros, Lancelot, est le fils du roi Ban de Benoic, province gauloise ; il est élevé par la Dame du Lac, qui le protège de ses ennemis en le cachant dans son palais, bâti au fond d’un lac. Le jeune chevalier arrive à la cour d’Arthur où il tombe amoureux de Guenièvre. Le Lancelot raconte les amours de Lancelot et de la reine, ainsi que les exploits chevaleresques du héros et de ses compagnons de la Table ronde. Sous l’influence d’un philtre, Lancelot, de passage au château du Graal, succombe à la tentation. Ainsi naît Galahad. Le romancier donne une large place aux guerres du roi Arthur, ainsi qu’à un thème désormais intégré à l’imagerie chrétienne, celui du Saint Graal. Ce long récit se termine au moment où le jeune Galahad arrive à Camelot. Vient ensuite La Queste du Saint Graal , où les chevaliers font le voeu de percer les mystères du Graal et de les montrer de façon plus « aperte », ou claire. Seuls Bohort, cousin de Lancelot, Perceval et Galahad parviennent à la ville sacrée de Sarras, où est célébrée enfin la messe du Saint Graal. Galahad est accueilli au paradis, Perceval meurt à Sarras, et c’est Bohort qui revient à la cour pour raconter ces merveilles. À Camelot, l’atmosphère oppressante qui caractérise les derniers jours de la « Queste », alors que sont morts plusieurs des compagnons de la Table ronde, devient plus lourde encore. La Mort le Roi Artu , dernier épisode du cycle, s’ouvre au moment où les ennemis de Lancelot révèlent au roi les amours adultères de la reine et de Lancelot. Arthur bannit son ami et quitte lui-même le royaume de Logres pour vaincre les Romains. Pendant son absence, son neveu Mordred – qui est aussi son fils – s’empare de la couronne et de la personne de la reine. Arthur revient et, aidé trop tard par Lancelot, tue son neveu dans une dernière bataille où succombe la fleur de la chevalerie arthurienne. Ainsi se trouve bouclé le cycle. Plus tard y furent ajoutés commentaires et explications, ainsi l’ Estoire del Saint Graal qui raconte comment le Graal, la coupe de la Cène, est apporté en Bretagne, et l’ Estoire de Merlin qui narre les premiers épisodes de la vie d’Arthur.
Cette immense somme n’est pas une compilation faite au hasard, qui rassemblerait dans un ordre quelconque, pour composer un « cycle » arthurien, des fragments de romans. Au contraire, c’est une oeuvre construite, et d’après un plan remarquable. La chronologie est strictement observée, et si nous sommes invités à abandonner, pour ainsi dire, les aventures d’un chevalier pour lire les exploits d’un autre, nous retrouverons plus tard la suite de l’épisode interrompu. On passe d’une aventure à une autre, mais à la fin tout s’éclaire. Chaque épisode renvoie à un autre, de sorte qu’il est impossible de découper arbitrairement le récit. C’est un tout indissociable. On a comparé le système à une tapisserie : « Si on y pratique des coupures, tout part en morceaux. »
Unique dans sa structure, complexe et remarquable, ce cycle ne comporte pas que des épisodes purement romanesques. On y aborde des thèmes profonds : le héros mondain, Lancelot, cède la place à son fils, Galahad, le héros touché par la grâce. La présence du Saint Graal se fait sentir bien avant la Queste. Les tribulations en Bretagne du Saint Graal ne peuvent trouver un terme que grâce à l’action d’un chevalier saint, presque un messie. Il ne s’agit plus de faire triompher l’idéal militaire de la chevalerie, mais de l’enrichir d’une sainte mission. Les valeurs spirituelles s’en trouvent rehaussées par rapport aux exigences mondaines. Ainsi raisonnait la dialectique médiévale.
Le cycle du Lancelot-Graal resta populaire jusqu’à la fin du Moyen Âge, et même pendant la Renaissance. De somptueux manuscrits, des exemplaires de luxe, furent copiés au XVe siècle et le nouvel art de l’imprimerie répandit ces textes dans un public plus large. La « Vulgate » fut remaniée et d’autres romans arthuriens en prose furent rédigés, tels le Tristan en prose, le Guiron le Courtois ou le roman de Palamède et la Compilation faite par Rusticien de Pise, sous le règne d’Édouard Ier d’Angleterre.
Les romans en vers
Le roman arthurien en vers ne disparut pas pour autant. Au roman de Perceval , que Chrétien de Troyes avait laissé inachevé, on ajouta des Continuations , dont les unes sont anonymes et d’autres l’oeuvre de Gerbert de Montreuil et de Manessier. Gauvain, le neveu du roi Arthur, y joue un rôle important. D’autres poèmes furent consacrés à Gauvain, par exemple les Enfances de Gauvain et le charmant poème anglais Sire Gauvain et le Chevalier Vert . Parmi les mieux construits des romans en vers, citons La Vengeance de Radiguel et Meraugis de Porlesguez , par Raoul de Houdenc, L’Âtre (ou le Cimetière) périlleux , Le Bel inconnu , que l’on a attribué à Renaut de Beaujeu, et le Roman d’Escanor . Le goût pour le long roman en vers persista jusqu’au XIVe siècle. Le plus long des romans arthuriens en vers est celui de Meliador que composa Jehan Froissart.
Dans tous ces romans en vers, nous retrouvons le décor familier de l’univers arthurien. Les royaumes de Logres, d’Écosse, de Cornouailles ou d’Irlande, où se trouvent les villes « arthuriennes » de Carlion, de Camelot, de Tintagel, sont fréquemment nommés. Les personnages arthuriens, le roi et son épouse Guenièvre, son neveu Gauvain, Mordred le traître, Lancelot et ses cousins Bohort et Lionel, la fée Morgain et Merlin, l’enchanteur et le prophète, évoluent sous les yeux du lecteur. Le plus souvent, le poète raconte la vie et les aventures d’un chevalier peu connu qui devient le héros du roman. Raoul de Houdenc choisit Meraugis de Porlesguez, le neveu du roi Marc de Cornouailles, Girard d’Amiens crée le roman d’ Escanor , un auteur inconnu nous raconte les amours de Floriant et Florete . Il serait fastidieux de dresser le catalogue complet du roman en vers : il suffit de préciser que la popularité du genre est à la mesure de la force de conviction de la légende arthurienne qui, au XIIIe siècle, comprend entre autres les romans de Tristan et Iseult , et les romans du Graal.
Les versions européennes
Les thèmes bretons se répandirent dans l’Europe entière. Les romans français servirent de modèle aux traductions et aux adaptations. Le poète allemand Hartman von Aue traduisit l’ Érec et l’ Yvain de Chrétien de Troyes. Wolfram von Eschenbach composa sa version du roman du Graal d’après l’oeuvre de Chrétien. La source française du Lanzelet d’Ulrich von Zatzikhoven n’a pas été conservée, mais ce roman biographique contient la version la plus vieille des « enfances » de Lancelot, traduites, à en croire Ulrich, d’après un livre français que posséda Hugh de Morville.
En Italie, la Tavola ritonda présente, sous forme de cycle, le roman d’Arthur. Des versions espagnole et portugaise d’un cycle tardif en prose offrent une Queste du Saint Graal , dont l’original français n’existe que sous la forme de fragments épars. Ajoutons que les romans arthuriens ont été traduits en scandinave, en néerlandais, en tchèque, etc., qu’il existe un roman provençal de Jaufré , et même des romans écrits directement en latin médiéval, tels De ortus Walwani et l’ Historia Meriadoci . Les pays celtiques, où les romanciers ont trouvé leurs thèmes, engendrent à leur tour des versions des romans arthuriens. Des versions galloises, les Mabinogion , offrent les mêmes récits que présente Chrétien de Troyes, outre le charmant poème de Kulwch et Olwen , et le magnifique Songe de Rhonabwy . Les liens qui unissent cette tradition galloise à la tradition française ont été souvent discutés. Disons que la tradition celtique est fort riche, et d’une valeur littéraire considérable.
Mais les thèmes bretons font retour à la Grande-Bretagne. D’une part, les romans français sont traduits en anglais ; Sir Tristrem ( Tristan et Iseult ), Arthour and Merlin , Lancelot of the Laik (version écossaise), The Holy Grail (l’ Estoire del Saint Graal ), Le Morte Arthur (version strophique de La Mort le Roi Artu ) en sont quelques-uns parmi les plus importants ; d’autre part, les poètes anglais ont composé des romans nouveaux, mais inspirés des romans français. Les poètes moyen-anglais ont fait de Gauvain leur héros favori ; citons Ywain and Gawain , Sir Gawain and the Carl of Carlisle , The Turk and Gawain ou The Green Knight . Ce dernier roman raconte la même histoire que celle que l’on trouve dans Sir Gawain and the Green Knight ( Sire Gauvain et le Chevalier Vert ), véritable chef-d’oeuvre qui nous est parvenu grâce à un manuscrit unique. Ce roman comprend deux thèmes principaux, celui de la triple tentation de Gauvain en présence de l’épouse du Chevalier Vert, et celui de l’épreuve de la décapitation. Le Chevalier Vert s’y soumet, à condition que son bourreau la subisse à son tour au bout d’un an. Le Chevalier Vert, Bercilak, ramasse sa tête coupée et disparaît ! Le style, la poésie, le réalisme de ce récit, qui caractérisent l’art exquis du conteur, en font un des romans arthuriens les plus achevés.
En Angleterre également, tout à la fin du Moyen Âge, les anciens romans arthuriens retrouvent une vogue nouvelle. L’imprimeur William Caxton avait eu l’heureuse idée d’éditer pour la première fois la traduction, ou plutôt le remaniement dont sir Thomas Malory était l’auteur. Dans une prose nerveuse, Malory fait revivre non seulement le cycle français, le Lancelot en prose, La Queste du Saint Graal et La Mort le Roi Artu , mais aussi une version anglaise de la Mort Arthure , le Tristan en prose et l’ Estoire de Merlin , ainsi qu’une Suite importante de ce dernier. C’est grâce à sir Thomas Malory que les romans de la Table ronde font partie du patrimoine littéraire des Anglais et qu’ils sont toujours vivants.
Qui était sir Thomas ? Un prisonnier politique, victime de la guerre des Deux-Roses ? C’est en 1485 que Caxton présente au public ces récits héroïques, où les méchants sont toujours punis. Pour cet éditeur, le roman comportait une morale : « Imitez le bon, fuyez le mal, et vous serez amenés à la bonne renommée », nous dit-il, faisant en cela écho aux romanciers français et aux vieux imprimeurs français qui, dans des prologues mis en tête des versions tardives des romans arthuriens, disent franchement : « Les choses mal faictes sont escriptes au livre pour les fouir et éviter, et les bonnes pour les ensuyvre, et les accomplir, chacun de bon voloir. »
À en croire les prologues, les romans de la Table ronde sont surtout des manuels de chevalerie. C’est la valeur littéraire et esthétique de ces textes, surtout de l’oeuvre de Malory, qu’il faut souligner.
Les origines du genre
Une floraison littéraire d’une telle richesse a attiré depuis longtemps l’attention des érudits. On s’est efforcé d’en expliquer la genèse et l’évolution. Pourquoi les exploits d’un héros étranger, du roi d’une terre conquise par les Normands ont-ils pris la place qu’occupaient autrefois les pairs de Charlemagne ? Les romans français se trouvent-ils à la source de la littérature arthurienne européenne ? Faut-il croire que les autres pays n’ont fait que remanier des textes français ? On serait tenté de reprocher aux spécialistes de n’avoir jamais pris une vue panoramique du problème. Les celtisants ne comprennent pas toujours le français médiéval ; les spécialistes du moyen-anglais ont des connaissances assez vagues de la langue irlandaise du Moyen Âge. En outre, nous retrouvons souvent dans toute cette littérature des motifs qui appartiennent au domaine du folklore, par exemple dans le Chevalier Vert ou le Château des Pucelles .
Deux hypothèses principales ont été avancées : selon la plus classique, voici comment les Français ont recueilli la tradition celtique. Après la conquête normande de l’Angleterre, les Français, qui avaient construit des châteaux sur les frontières actuelles du pays de Galles, eurent des contacts répétés avec les Gallois. Rien de plus naturel, pour les romanciers anglo- normands, que d’emprunter les thèmes littéraires de leurs voisins. Ajoutons que le chroniqueur Giraldus Cambrensis (le Gallois) nomme un certain Bledhericus , famosus fabulator , c’est-à-dire un conteur gallois dont le nom se trouve dans le roman français de Tristan , sous la forme Bréri, ainsi que dans d’autres romans arthuriens français. Ferdinand Lot, Joseph Lot et, plus récemment, Jean Marx ont insisté sur l’importance des rapports directs entre Gallois et Normands.
Mais comment expliquer que le poème gallois de Kulwch et Olwen n’ait pas de rapport apparent avec les autres épisodes des Mabinogion ? Que les poèmes en moyen-anglais ont, pour la plupart, des sources françaises et non des sources galloises ? La seconde hypothèse, avancée par des savants gallois, met en lumière l’intervention d’Armor et des ménestrels. Joseph Bédier, dans son édition du Tristan de Thomas, l’a décrite de façon magistrale. Après la bataille d’Hastings, « toute la civilisation normande se trouva brusquement transplantée telle quelle dans les châteaux d’outre-Manche, et les jongleurs armoricains y suivirent leurs patrons : jongleurs armoricains, mais plus qu’à demi romanisés, mais vivant au service de seigneurs français et contant pour leur plaire ». Il paraît donc probable que les récits celtiques ont été livrés aux conteurs français par l’intermédiaire des ménestrels bretons, qui étaient bilingues, ou même trilingues. Mais c’est grâce aux auteurs français que le cycle arthurien s’est répandu dans l’Europe entière. On a beaucoup disputé de l’importance de la contribution celtique. Chrétien de Troyes, par exemple, a-t-il tout inventé, ou trouve-t-on dans ses oeuvres une large part d’inspiration celtique ? Ne nous transmet-il pas des mythes dont il n’a pas saisi tout le sens ? Le royaume de Gorre, un pays entouré par un fleuve dangereux que l’on ne traverse que par le Pont de l’Épée ou le Pont sous l’Eau, évoque l’Autre Monde des Celtes. Le beau verger, ceint d’une muraille « invisible comme l’air, mais résistante comme l’acier », et d’une palissade où sont plantées les têtes coupées des vaincus, verger qui est le théâtre de la « Joie de la Court » dans Érec , fait songer, lui aussi, à la mythologie celtique. L’ Île Noire , ou l’ Île de Voire , l’ Insula Vitrea de Glastonbury, n’est-il pas un autre souvenir celtique que conserve La Mort le Roi Artu ? Jean Frappier départage les tenants des origines françaises du cycle arthurien des partisans de la souche celtique : c’est, en effet, des rapports entre deux civilisations, l’une celtique et l’autre française, et grâce à l’intermédiaire des conteurs bretons, qu’est né le roman arthurien.
Reste la question de la chronologie. Rien n’est plus difficile que de dater d’une façon précise une oeuvre médiévale. La chronologie des oeuvres de Chrétien de Troyes est établie avec une certaine exactitude, ainsi que la date du cycle de la « Vulgate ». Quant aux versions tardives des romans en prose, on les situe de deux façons. F. Bogdanow croit à l’existence d’un Roman du Graal , composé postérieurement au cycle de la « Vulgate », mais qui n’est conservé que sous la forme de fragments en langue française, anglaise, espagnole et portugaise. D’autres critiques ont émis une hypothèse selon laquelle ces fragments n’ont jamais formé un cycle homogène, mais représentent des tentatives d’auteurs différents à des époques différentes pour combler les lacunes du déroulement de l’histoire arthurienne. Pour éclairer certaines obscurités, ces auteurs auraient imaginé des épisodes supplémentaires. Ainsi Arthur, à la fin de La Mort Artu , jette dans un lac son épée Excalibur. On nous montre comment il l’a trouvée, toujours dans un lac. La question des sources a retenu l’attention des chercheurs à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On a cru que les textes parvenus jusqu’à nous ne représentaient que les fragments épars d’une série de cycles aujourd’hui perdus ; on a donc imaginé de vastes rédactions, dont il ne subsiste que les disjecta membra . Mais à partir des Études de Ferdinand Lot sur le Lancelot en prose, de Vinaver sur le Tristan en prose, de Pauphilet et de Frappier sur La Queste du Saint Graal et La Mort le Roi Artu , de Jeanne Lods sur le Perceforest , on a examiné de façon plus attentive les textes que nous possédons. Entre autres, les mérites littéraires des textes en prose furent ainsi mis en valeur. On a souligné que le cycle arthurien a continué d’évoluer, de se développer. Les textes les plus récents ne sont plus considérés comme les textes les moins beaux. L’histoire littéraire d’Arthur n’apparaît plus comme un rassemblement fragmentaire, mais comme une floraison. On ne parle plus de « variantes banales d’aventures » (Gaston Paris), mais de la genèse d’un roman, d’un « prolongement rétroactif » non dépourvu d’intentions esthétiques.
L’architecture complexe du roman en prose, la sonorité des romans en vers, et même les imprimés plus récents ne cessent de retenir l’attention des érudits. La Société internationale arthurienne leur propose une académie, où l’étude de la littérature inspirée par l’épopée du vieux roi breton s’enrichit tous les jours.
(c) 1995 Encyclopædia Universalis France S.A.
Tous droits de propriété intellectuelle et industrielle réservés.